Suite à ces investigations graphiques, nous avons effectué un workshop croisé, autrement dit avec mon camarade de classe Arthur PEREIRA nous avons échangé nos sujet le temps d’une semaine. De par sa projection dans des prototypes plus fonctionnels, j’ai pu me projeter et faire un point sur mes propres recherches. J’en ai conclu que l’axe holographique était le plus prometteur, car techniquement plus stimulant. De surcroît, il était plus cohérent pour exprimer la corrélation entre science et SF.
> 1· éléments graphiques
 fig.23 Exploration sur surface plane et en profondeur
fig.23 Exploration sur surface plane et en profondeur J’ai ainsi précisé mes intentions pour le concept de l’interface. À la manière d’un scientifique dans un laboratoire, le principe est de combiner les expériences scientifiques et les films de SF récolté. Ces matériaux assemblés permettent d’obtenir les avancées scientifiques impactant la société. Tous ces résultats (appartenant à 5 thématiques définies par livre de la SF du théoricien Jacques BAUDOU), forment ensuite un schéma global de l’avenir. Pour être plus explicite je procède à la manière de l’atomic design, une méthode conception d’interface : les films et recherches scientifiques deviennent des atomes, tandis que les avancées scientifiques incarnent les molécules et enfin les thématiques des organismes.
Pour concevoir cette banque d’éléments graphiques, je me suis appuyée sur une grille circulaire, explorant à la fois une surface plane et des plans en profondeur [fig. 23]. Cependant le volume s’est avéré plus impactant et cohérent pour simuler un aspect holographique. Cela m’a permis de former un nouveau langage abstrait projetant l’utilisateur dans le futur par la mise à distance du réel, contrairement à l’illustration.
 fig.24 Recherche de matérialités
fig.24 Recherche de matérialités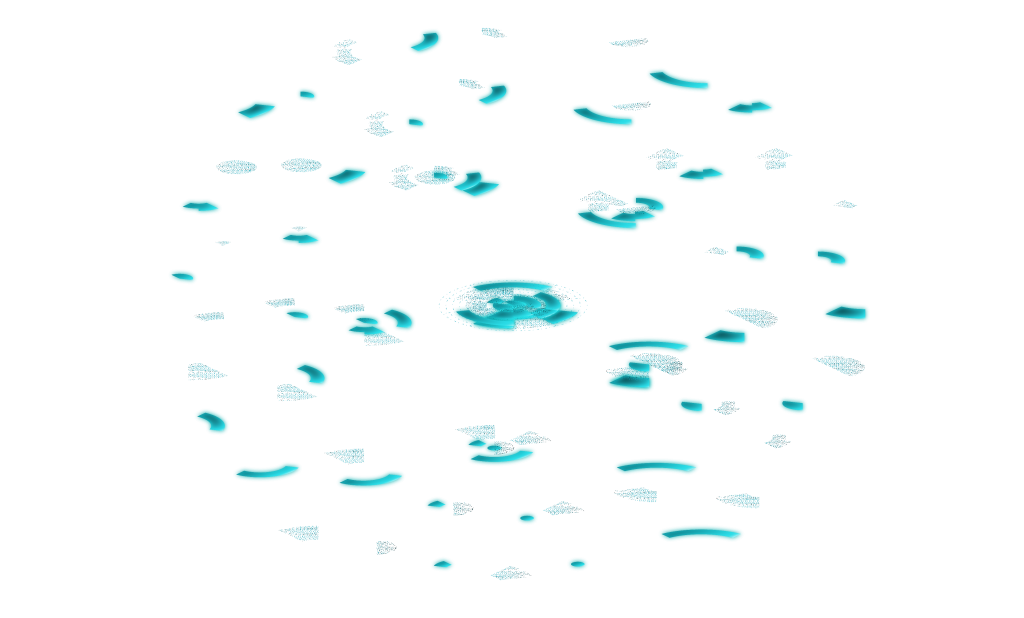
 fig.25 Schéma déployé sous forme de carte mentale
fig.25 Schéma déployé sous forme de carte mentale
 fig.25.bis Schéma final déployé sous forme holographique
fig.25.bis Schéma final déployé sous forme holographiqueAinsi, j’ai formé deux aspects distincts [fig. 24], l’un associé aux éléments scientifiques par son accumulation de détails et l’autre aux films de SF par sa luminosité et sa fluidité. Grâce à mes expériences en risographie, j’ai affiné l’esthétique de mes éléments graphiques en ajoutant du grain. Ce qui permet d’apporter de l’harmonie et de l’authenticité.
Ensuite, j’ai cherché à composer avec ces éléments un schéma. Au départ, j’ai entrevu une déclinaison avec un schéma proche d’une carte mentale, puis je me suis tournée vers un unique hologramme [fig. 25]. Cette deuxième déclinaison évitait la saturation visuelle et la répétition futile.
> 2· logotype

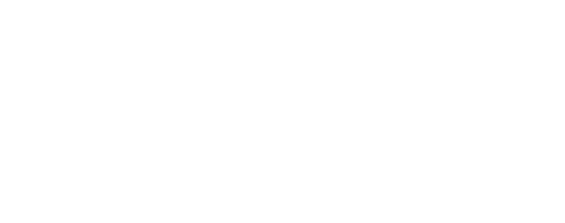
 fig.26 Exploration de logotypes
fig.26 Exploration de logotypes
 fig.27 Structure finale
fig.27 Structure finale 
 fig.28 Logotype final
fig.28 Logotype finalEn parallèle, j’ai développé le logotype [fig. 26], il s’agissait de trouver un équilibre entre son aspect prospectif et sa lisibilité, ce qui faisait défaut à mes prémices d’identité visuelle. S’agissant des couleurs que j’arbore par ailleurs depuis le début de mes recherches, elles sont guidées à la fois par l’identité visuelle minimaliste des Utopiales et leurs symboliques. Le noir et le blanc par excellent représentent l’opposition entre deux mondes, tandis que le bleu opère un lien. Comme nous pouvons l’observer dans la composition [fig. 27], la hauteur de capitale est ascendante de l’intérieur vers l’extérieur, le regard est guidé vers ce « E » mimant un hologramme [fig. 28]. De surcroît, ce bleu turquoise n’est pas choisi par hasard, c’est une couleur dominante aussi bien dans les interfaces de films de SF que dans le domaine scientifiques.


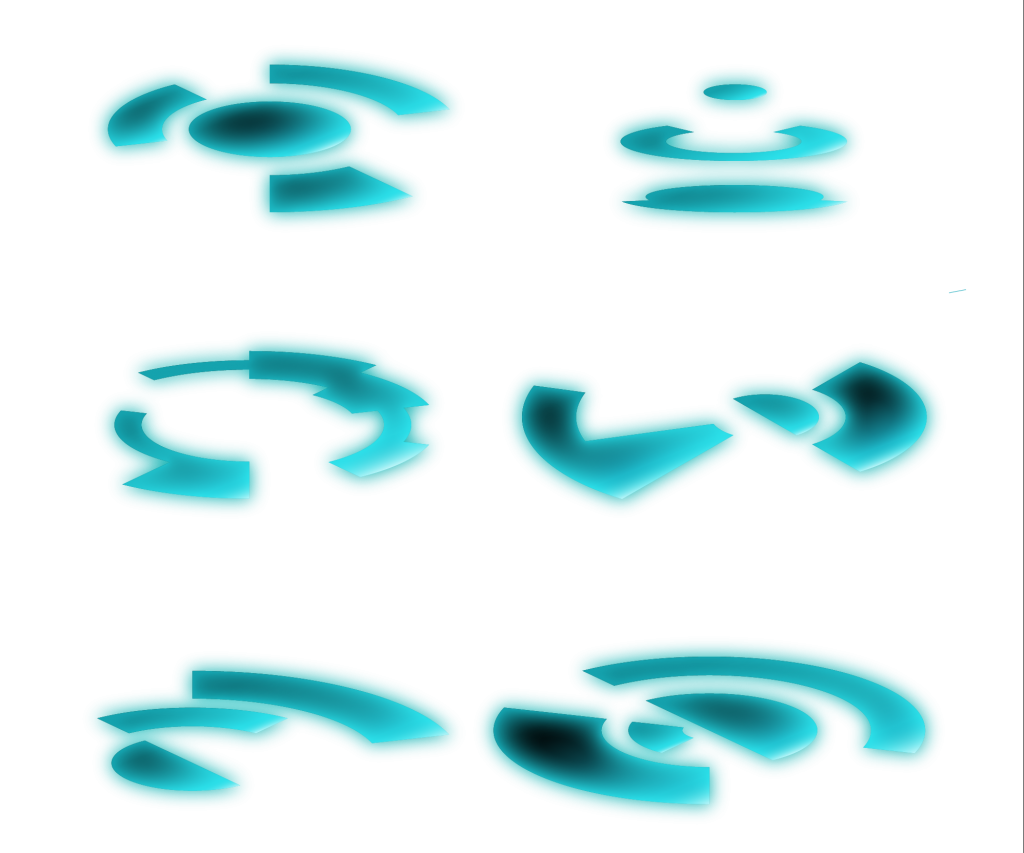

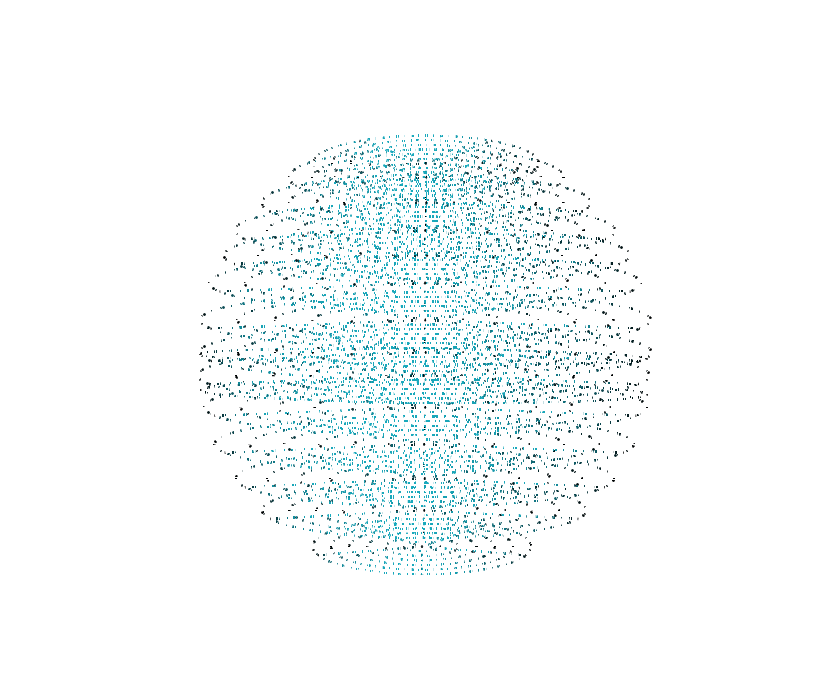

 I· Cahier des charges fictif
I· Cahier des charges fictif III· Prototype prospectif
III· Prototype prospectif